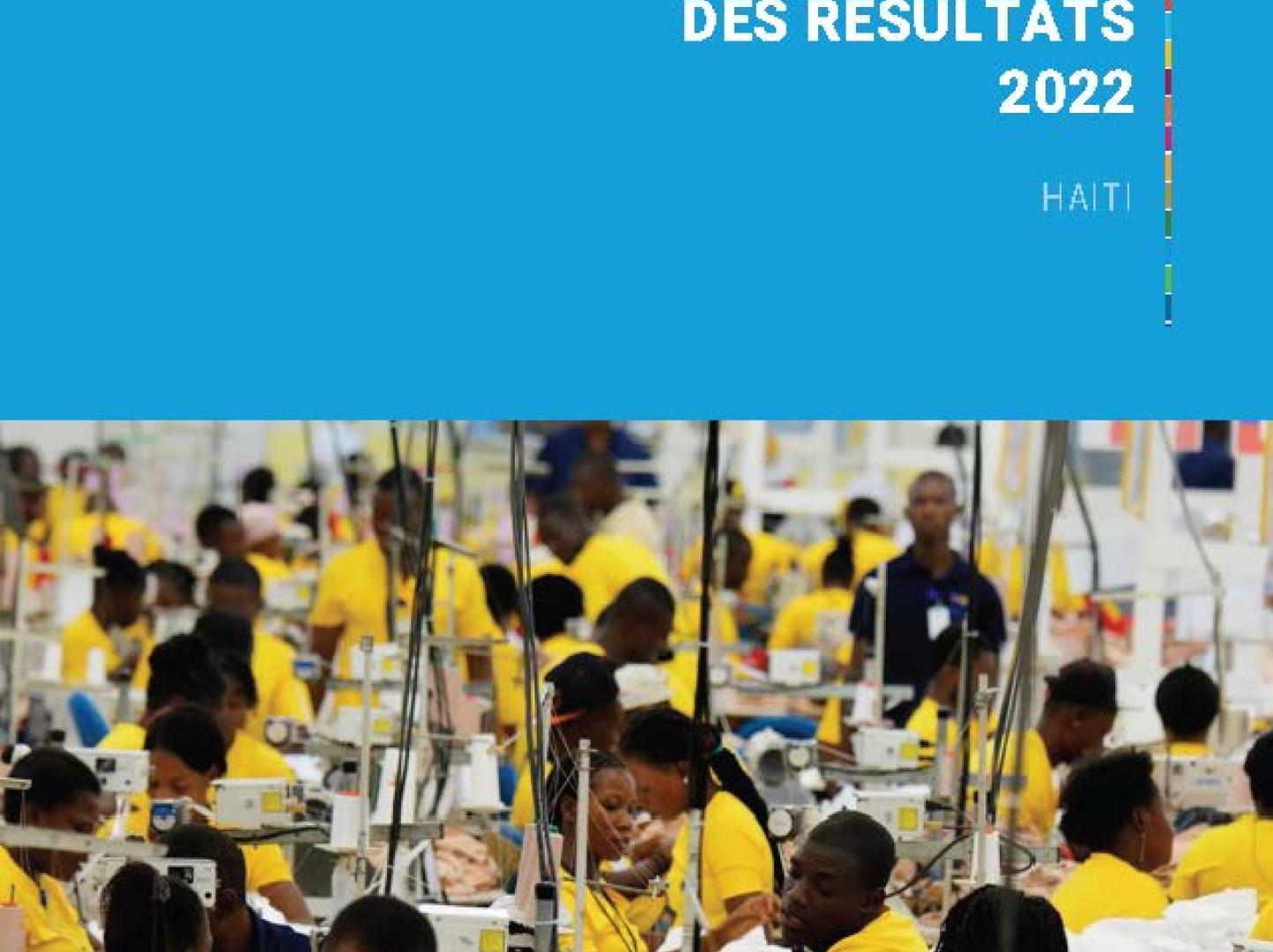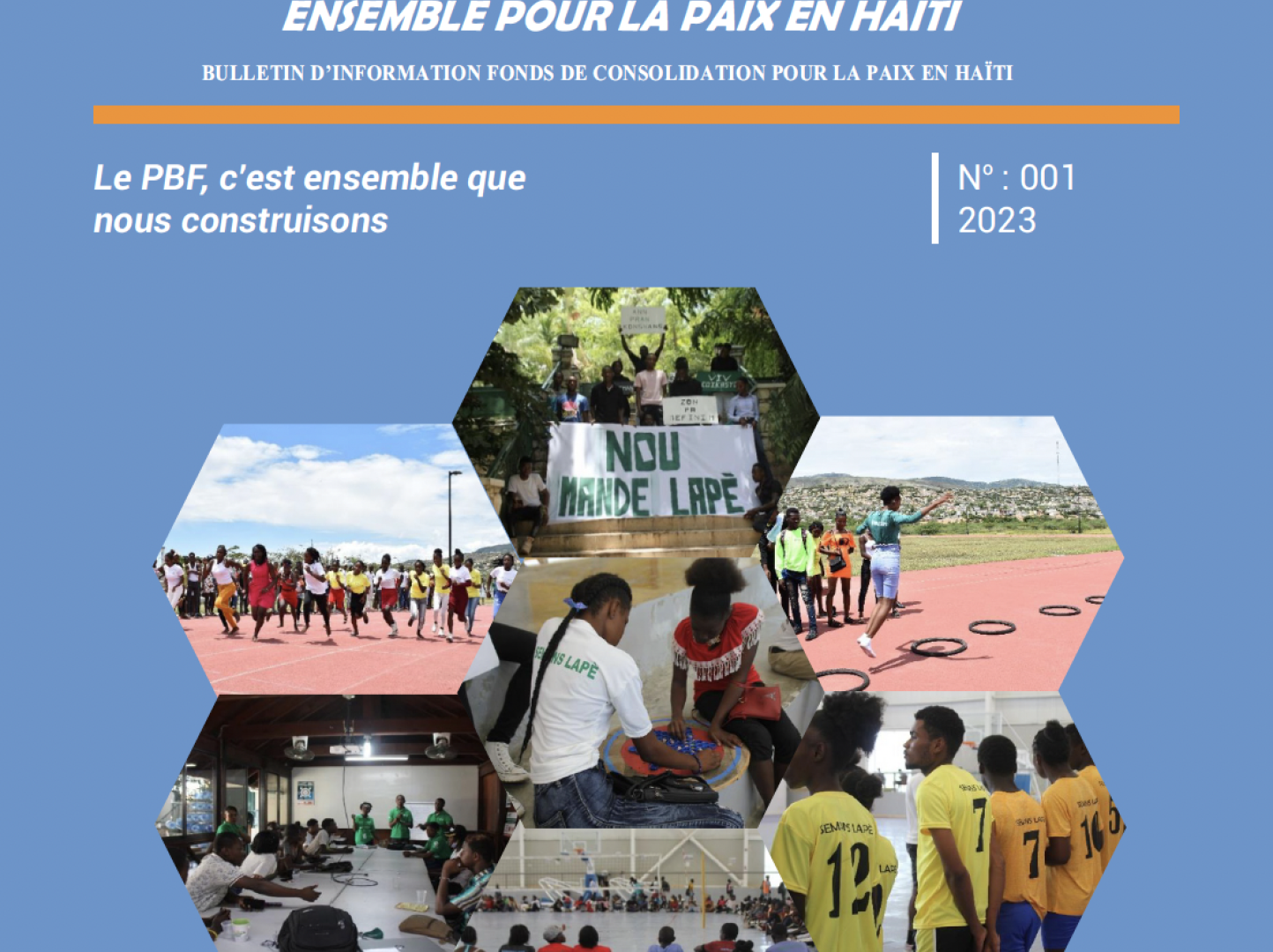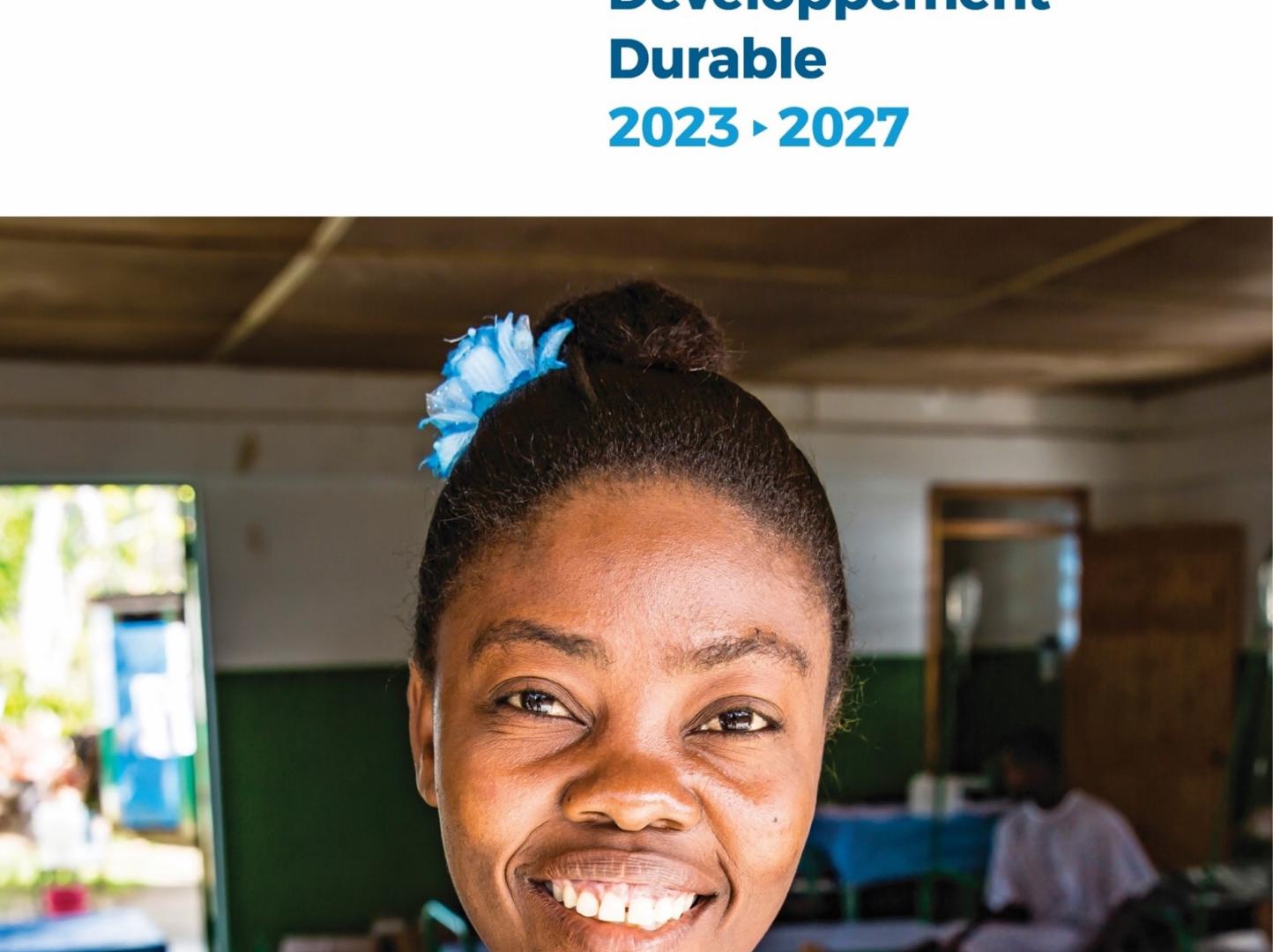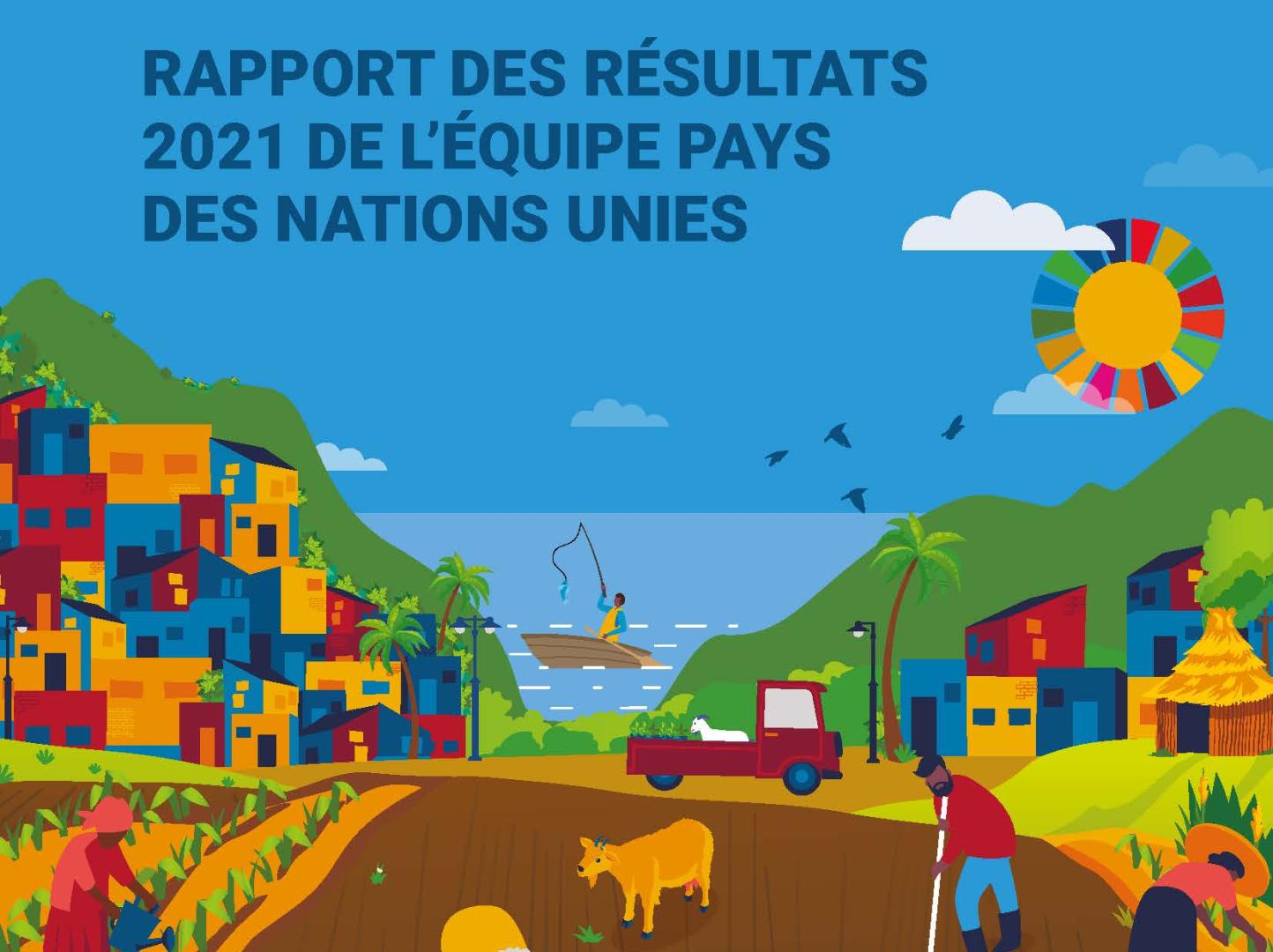Dernières actualités
Communiqué de presse
18 décembre 2025
LANCEMENT DU PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2026 EN HAÏTI POUR VENIR EN AIDE À 4,2 MILLIONS DE PERSONNES
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
01 décembre 2025
Haïti : Journée Mondiale SIDA 2025 - « Surmonter les perturbations, transformer la riposte »
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
30 octobre 2025
Ouragan Melissa - L’Équipe pays des Nations Unies en Haïti exprime sa profonde solidarité avec le peuple Haïtien et les pays des Caraïbes face aux ravages de l’ouragan Melissa.
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable en Haïti
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU en Haïti.
Publication
04 septembre 2025
Analyse commune de pays (CCA) - Haïti - 2025
Lancé en mai 2024, le processus de mise à jour de l’Analyse commune de pays s’est appuyé sur une approche collaborative, mobilisant l’ensemble des entités du Système des Nations Unies afin d’affiner l’Analyse de 2022, en tenant compte des risques émergents pour identifier les leviers d’action en faveur d’une réponse intégrée et adaptée. Le texte couvre les données statistiques de la période d’octobre 2022 à mars 2025, de manière variable. Il inclut également de brèves références en notes de page à des évolutions majeures survenues entre mars et juin 2025. Ces faits seront pris en compte dans la prochaine mise à jour.Les échanges préparatoires en amont du travail d’analyse ont confirmé non seulement la persistance, mais aussi l’aggravation des défis identifiés en 2022, qu’il s’agisse de l’impunité, de la gouvernance défaillante, de l’exclusion économique ou des liens systémiques entre réseaux politiques, intérêts économiques et violence. Fait notoire, le phénomène de justice populaire, (communément appelé “bwa kale”), s’est intensifié suite aux évènements de 2024. Ces dynamiques ont continué à miner la cohésion nationale et à affaiblir la légitimité de l’État. Les indicateurs de pauvreté, d’insécurité alimentaire, de mobilité forcée, de destruction des services publics et de fragmentation institutionnelle ont atteint des niveaux critiques. Parallèlement, l’intensification des violences armées, la désagrégation de l’appareil sécuritaire, les tensions régionales croissantes, la multiplication des catastrophes naturelles et leurs effets différenciés sur les groupes vulnérables – notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap – imposent une relecture des priorités stratégiques pour les Nations Unies.Dans ce contexte, cette mise à jour vise à offrir un diagnostic rigoureux et multidimensionnel, tout en constituant un socle analytique pour l’identification d’ajustements à la mise en œuvre du Plan-cadre de coopération des Nations Unies (UNSDCF) 2022-2027. Veuillez télécharger le fichier PDF pour accéder au contenu complet de l'Analyse
1 / 5

Publication
22 mai 2025
Rapport annuel des résultats 2024 de l’Équipe Pays des Nations Unies en Haïti
L’année 2024 restera gravée dans nos mémoires comme une période d’épreuves et de résilience. Haïti a traversé une crise sans précédent, marquée par une situation économique toujours plus précaire et une insécurité galopante, affectant chaque aspect de la vie quotidienne. La violence des gangs armés a plongé des milliers de familles dans le deuil, la peur et a causé des déplacements forcés, exacerbant les vulnérabilités et menaçant les droits fondamentaux des populations, en particulier des femmes et des enfants.Dans cet environnement complexe, l’Équipe pays des Nations Unies a su s’adapter, innover et redoubler d’efforts pour continuer à soutenir les populations les plus touchées. Avec un engagement renouvelé, elle a mis en place des stratégies conciliant réponse humanitaire et actions de développement. Ainsi, nous avons renforcé des chaînes de valeur agricoles pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, soutenu des structures éducatives et sanitaires, et intensifié nos actions en faveur de la protection de l’environnement et des paysages résilients. Parallèlement, nous avons appuyé des activités de plaidoyer initiées par des organisations de la société civile haïtienne en faveur des droits humains. Nous avons aussi contribué au renforcement de la justice dans un contexte en proie aux violences et aux exactions. Face à la crise humanitaire et sécuritaire, nous avons réaffirmé notre soutien aux autorités de transition dans leurs efforts de stabilisation et de renforcement des institutions démocratiques. Nos initiatives sont alignées sur les objectifs du «Pacte pour l’avenir» qui visent à favoriser une gouvernance inclusive et à poser les bases d’une paix durable. Dans ce cadre, le plaidoyer et l’accompagnement pour la tenue d’élections libres et transparentes ont constitué un axe d’intervention fondamental.Le renforcement de notre présence sur l’ensemble du territoire haïtien, et la collaboration accrue avec des organisations locales haïtiennes nous ont permis d’être plus efficace et de nous adapter face aux réalités complexes du terrain. Je vous invite, donc, à prendre connaissance des résultats présentés dans ce rapport de 2024, témoignant de la résilience et du courage du personnel des Nations Unies en Haïti, ainsi que de l’engagement de nos différents partenaires techniques et financiers qui continuent d’investir leurs efforts, pour donner de l’espoir aux Haïtiennes et Haïtiens, et parvenir à un pays économiquement fort, socialement juste, et politiquement stable et démocratique. Ulrika RichardsonCoordonnatrice résidenteCoordonnatrice humanitaire
1 / 5

Publication
20 avril 2023
Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2023-2027
Le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable représente l’engagement collectif de l’ONU en Haïti afin d’accompagner les efforts du pays dans la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable et assurer une mise en œuvre du Programme Commun des Nations Unies ainsi que le Nouvel Agenda pour la Paix.
Le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable est aligné sur les priorités du Plan Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH) et sur la vision du Gouvernement visant à faire d’Haïti un pays émergent. Élaboré sur la base des principes de la réforme du Système des Nations Unies, ce Cadre de Coopération marque un nouvel élan dans le partenariat entre l’ONU et le Gouvernement pour la période 2023-2027. Il repose sur une vision partagée des défis et des opportunités du pays. Il s’aligne aussi sur les recommandations issues de l’Examen périodique universel (EPU) d’Haïti de 2022 et fait écho aux valeurs de justice, de liberté et de dignité portées par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
1 / 5
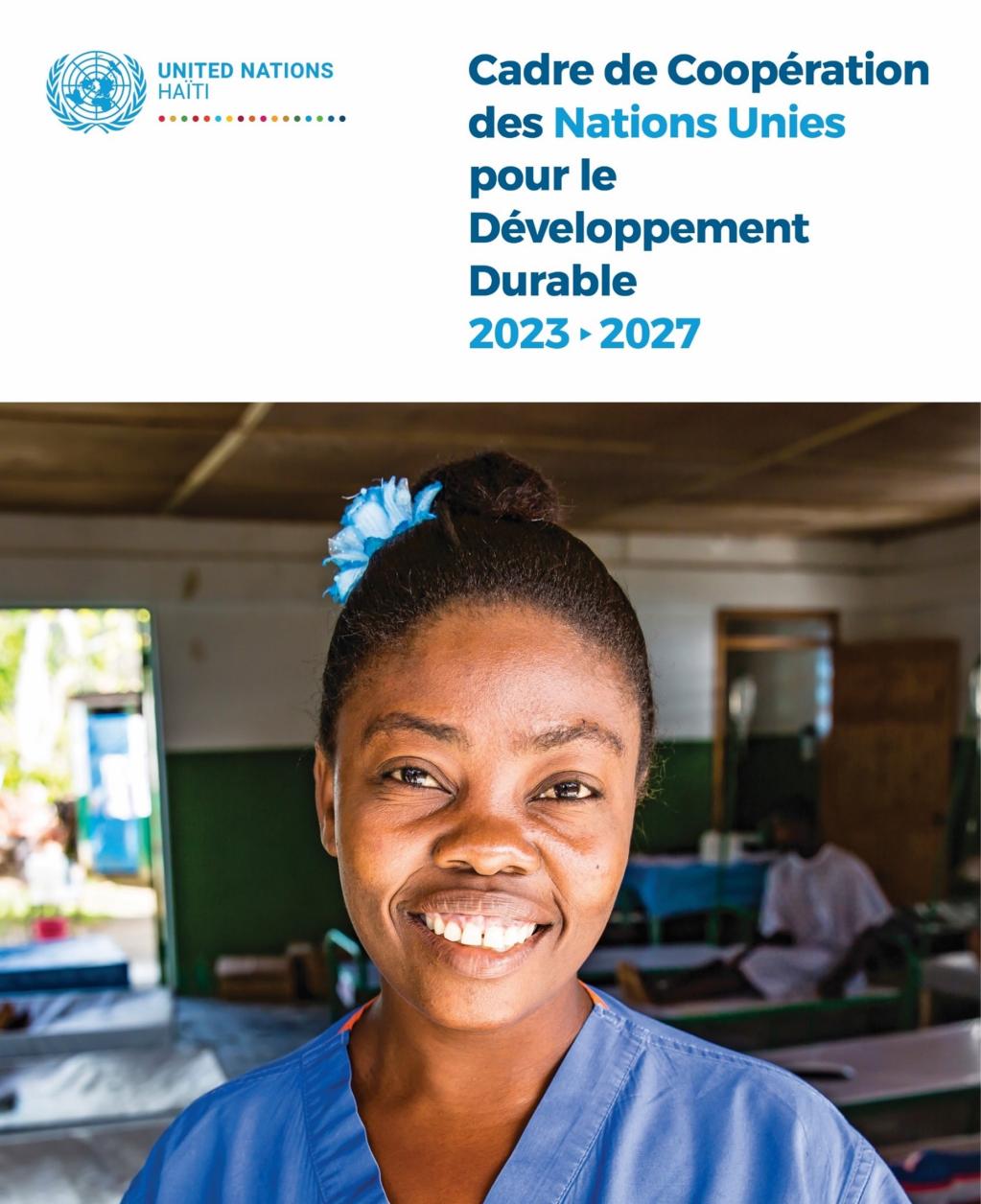
Communiqué de presse
22 avril 2025
Les Nations Unies réitèrent leur soutien à Haïti : entre résilience et appel à l’engagement
L’événement a mis en avant les besoins immédiats et à long terme du pays, tout en étant un espace de renforcement du plaidoyer pour maintenir Haïti comme une priorité dans les agendas humanitaires et de développement mondiaux, pour que les Haïtiens puissent réaliser leurs droits à la stabilité, la dignité, et le droit à vivre dans un environnement pacifique. Cet événement a valorisé le travail essentiel des acteurs humanitaires et du développement dans un contexte sécuritaire difficile et face à une crise humanitaire alarmante, pour apporter une aide substantielle aux populations vulnérables, notamment à Port-au-Prince et dans l’Artibonite, qui sont contraintes de fuir leurs domiciles pour échapper aux assauts répétés des gangs armés, et à cette violence qui touche de manière disproportionnée les femmes et les enfants. À travers Haïti, plus d’un million de personnes sont déplacées, soit un triplement de leur nombre au cours de l’année écoulée. Environ 5,7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population du pays, sont en insécurité alimentaire aiguë, y compris plus de 8 000 personnes vivant dans des sites de déplacés internes.Organisé en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale, cet événement a réaffirmé l’engagement des Nations Unies à rester présentes sur le terrain. « L’équipe humanitaire et de développement des Nations Unies, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, apporte une réponse à la crise en Haïti, notamment aux plus vulnérables, en fournissant des soins médicaux, de la nourriture, de l’eau potable, des services en éducation, entre autres. Mais, au-delà de l’urgence, nous travaillons également à adresser les principales causes de l’instabilité, car les Haïtiens veulent et méritent de vivre en paix, dans la stabilité et dans la dignité », Ulrika Richardson, Coordonnatrice résidente et humanitaire.Les Nations Unies en Haïti renforcent leur empreinte également dans les régions moins affectées par la crise sécuritaire. A travers des initiatives conjointes, et en collaboration avec les partenaires nationaux, les Nations Unies œuvrent à la protection de l’environnement, au développement de paysages résilients, à la création d’emplois décents et à l’autonomisation des femmes, au renforcement de l’agriculture locale et de chaînes de valeur porteuses, au renforcement institutionnel ainsi qu’à la construction et la réhabilitation d’infrastructures agricoles, éducatives et sanitaires, entre autres.Avec cet événement, les Nations Unies réaffirment leur engagement à appuyer le pays dans sa quête de stabilité, de paix et de progrès durable, tout en appelant les partenaires du monde entier à renforcer également leur engagement constructif envers Haïti et le peuple Haïtien. Contact - MédiaJefferson BelizaireAssociate Development Coordination Officer, Programme Communications and Advocacyjefferson.belizaire@un.org
1 / 5
Communiqué de presse
19 mai 2025
L’équipe humanitaire pays en Haïti exprime sa vive préoccupation face à la déportation de femmes enceintes et allaitantes depuis la République dominicaine
Selon les dernières données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 20 000 personnes – dont un nombre croissant de femmes en situation de grande vulnérabilité – ont été expulsées par voie terrestre en avril 2025, un record sur une période d’un mois. Aux points de passage frontaliers de Belladère et Ouanaminthe, l’Office national de la migration (ONM) et l’OIM, en coordination avec d’autres partenaires, ont assisté en moyenne 15 femmes enceintes et 15 mères allaitantes par jour depuis le 22 avril.« Il est impératif que les engagements pris en matière de protection des personnes vulnérables soient respectés. Ces expulsions soulèvent des préoccupations sérieuses sur le plan humanitaire et des droits humains, en particulier lorsqu’elles touchent des femmes enceintes ou des mères avec de très jeunes enfants », a déclaré Ulrika Richardson, Coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti.Ces déportations s’ajoutent à une crise humanitaire complexe qui affecte des millions de personnes à travers le pays. Les violences armées dans plusieurs régions du pays ont entraîné le déplacement de plus d’un million de personne.Par ailleurs, l’insécurité alimentaire continue de s’aggraver à l’échelle nationale. Plus de 5,7 millions de personnes – soit la moitié de la population – sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire aiguë, avec des poches de conditions proches de la famine.En réponse à cette situation, les agences des Nations Unies et leurs partenaires humanitaires, en coordination avec les autorités haïtiennes, se mobilisent pour répondre aux besoins les plus urgents, notamment par la fourniture d’eau potable, de kits d’hygiène adaptés, de soins médicaux, d’un hébergement temporaire, de soutien psychosocial, et d’une aide alimentaire.L’équipe humanitaire en Haïti appelle à des approches migratoires respectueuses de la dignité humaine, et à une solidarité régionale renforcée pour faire face à une crise qui dépasse les frontières et met en péril les droits et la vie de milliers de personnes. Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Claire-Emmanuelle Pressoir, Officier de l'information publique, OCHA Haïti, Port-au-Prince
claire.pressoir@un.org Article paru sur Haiti | ReliefWeb
Claire-Emmanuelle Pressoir, Officier de l'information publique, OCHA Haïti, Port-au-Prince
claire.pressoir@un.org Article paru sur Haiti | ReliefWeb
1 / 5
Histoire
17 octobre 2025
Pourquoi 500.000 armes illégales sont-elles en circulation en Haïti malgré l’embargo décrété par l’ONU ?
On estime que jusqu'à 500.000 armes illégales, allant des armes de poing aux fusils semi-automatiques de guerre, sont entre les mains de gangs en Haïti, alors même que ce pays des Caraïbes est soumis à un embargo sur les armes décrété par l'ONU depuis trois ans. Haïti est confronté à une grave crise sécuritaire : des gangs rivaux se disputent le contrôle de la capitale, Port-au-Prince, et des zones environnantes, tout en terrorisant les habitants par des extorsions, des violences sexuelles, des enlèvements et des meurtres.Face à ces violences, les États membres de l'ONU avaient convenu d'imposer un embargo sur les armes à Haïti en 2022.Vendredi, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité une résolution qui reconduit pour un an le régime de sanctions en Haïti, y compris l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs. Il a aussi ajouté deux personnes à la liste des sanctions prévues par la résolution de 2022. Malgré les efforts de la communauté internationale, qu'est-ce qui a mal tourné ? ONU info répond à cinq questions pour mieux comprendre la situation en Haïti.Combien y a-t-il d'armes en Haïti ?Haïti ne fabrique pas d'armes à feu ni de munitions, mais selon les derniers chiffres publiés par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, on estime qu'il y a entre 270.000 et 500.000 armes illégales en circulation.Elles ne sont pas seulement entre les mains des nombreux gangs meurtriers, mais aussi courantes parmi le nombre croissant de groupes d'autodéfense qui tentent de protéger les personnes et les biens dans les quartiers troublés de Port-au-Prince.L'impact d'un tel nombre d'armes dans une zone métropolitaine d'environ 2,6 millions d'habitants est dévastateur. Rien qu'en 2024, plus de 5.600 personnes ont été tuées dans le cadre d'activités liées aux gangs, selon l'ONU.Les violations et abus des droits humains documentés par l'ONU comprennent des massacres, des enlèvements contre rançon, des viols et des exploitations sexuelles, la destruction de biens et des restrictions sévères à l'accès aux services essentiels, en particulier aux soins de santé et à l'éducation. Quelles armes à feu sont en circulation ?Il est difficile d'estimer avec précision le nombre d'armes à feu illégales entre les mains des gangs et des groupes d'autodéfense, mais certains indices montrent que des armes plus sophistiquées et plus meurtrières sont utilisées.Les autorités haïtiennes ont peu de succès dans leurs efforts pour mettre fin au trafic d'armes. Cependant, une cargaison d'armes achetées à Miami aux États-Unis, et interceptée en République dominicaine en février 2025 comprenait un fusil semi-automatique lourd Barret M82, des fusils de précision, une mitraillette Uzi et plus de 36.000 cartouches. Que dit l'embargo ?L'embargo sur les armes, ainsi que les interdictions de voyager et le gel des avoirs visant certaines personnes ont été autorisés par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2022.Ciblant spécifiquement les gangs et les individus jugés responsables de menacer la paix et la sécurité en Haïti, l’embargo appelle les États membres de l'ONU à interdire l’approvisionnement, la vente ou le transfert d'armes de tous types. Il interdit aussi l'assistance technique, la formation et le soutien financier liés aux activités militaires, et reconnaît que la situation en Haïti constitue une menace pour la paix régionale. Comment l'embargo est-il contourné ?L’embargo est contourné principalement par des itinéraires de trafic depuis les États-Unis, principalement depuis Miami, mais également depuis New York via la République dominicaine, souvent en raison de la faiblesse des contrôles douaniers et de la corruption.Certaines cargaisons réussissent cependant à être interceptées par les autorités américaines avant d'atteindre Haïti.Il existe également des preuves d'expéditions d'armes depuis le Venezuela et d'autres pays d'Amérique du Sud. Les armes sont souvent dissimulées dans des cargaisons mixtes ou déclarées comme des marchandises humanitaires ou commerciales afin d'échapper aux contrôles.Il y a aussi des inquiétudes croissantes que des fusils d’assaut initialement enregistrés auprès de sociétés de sécurité privées opérant en Haïti finissent entre les mains de membres de gangs. Que faut-il faire pour garantir le respect de l'embargo et comment l'ONU apporte-t-elle son aide ?L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui s'occupe des questions de trafics, déclare que pour garantir le respect de l'embargo, il faut adopter « une approche globale et coordonnée aux niveaux national, régional et international ».« La lutte contre la corruption et les flux financiers illicites reste également essentielle pour assurer le respect de l'embargo », affirme l'agence onusienne.Cela signifie qu'il faut doter les autorités douanières, portuaires et frontalières haïtiennes des capacités techniques nécessaires pour détecter, intercepter et enquêter sur les transports d'armes illicites.À l'heure actuelle, il n'existe pas un seul scanner grand format dans tout Haïti qui permette d'identifier efficacement le contenu d'un conteneur ou d'un camion.Étant donné que la plupart des armes entrent en Haïti par voie maritime, il est essentiel d’améliorer la sécurité maritime et portuaire – y compris les inspections – ainsi que de travailler plus efficacement avec les autorités chargées de l’application de la loi dans les pays d’origine.De plus, l'octroi de ressources supplémentaires le long de la frontière poreuse avec la République dominicaine, qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti, contribuerait à mettre fin au trafic illicite par des points de passage non officiels.L'ONU contribue à la coordination entre Haïti et d'autres pays de la région afin de garantir le respect de l'embargo, et fournit une assistance technique pour renforcer le traçage des armes, les contrôles douaniers et les enquêtes financières.« La lutte contre la corruption et les flux financiers illicites demeure également essentielle au respect de l'embargo », souligne l'ONUDC.Étant donné qu'Haïti ne fabrique ni armes ni munitions, la seule interruption de l'approvisionnement en balles mettrait fin à la capacité des gangs à s'affronter et à terroriser les communautés.
Article publié sur ONU Info
Article publié sur ONU Info
1 / 5

Histoire
03 octobre 2025
Mme Nicole Flora Boni Kouassi de la Côte d'Ivoire – Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et Coordonnatrice résidente en Haïti
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination de Nicole Flora Boni Kouassi, de la Côte d'Ivoire comme sa nouvelle Représentante spéciale adjointe pour le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) et Coordonnatrice résidente en Haïti. Mme Boni Kouassi assumera également la fonction de Coordonnatrice humanitaire.Mme Boni Kouassi succède à Ingeborg Ulrika Ulfsdotter Richardson, de Suède, à qui le Secrétaire général exprime sa gratitude pour son service dévoué et son engagement indéfectible envers les Nations Unies.
Mme Boni Kouassi apporte à ce poste plus de 22 ans d’expérience au sein de l’ONU, avec une expertise approfondie dans les domaines du développement, de la paix et de la sécurité, ainsi que de l’action humanitaire. Elle occupe depuis 2022 le poste de Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Niger, où elle a également assuré les fonctions de Coordonnatrice résidente et humanitaire par intérim entre 2023 et 2024. Auparavant, elle a été Représentante résidente du PNUD au Burundi entre 2019 et 2022, et Coordonnatrice résidente et humanitaire par intérim en 2021.
Précédemment, elle a également occupé plusieurs postes de direction, notamment en tant que Représentante résidente adjointe du PNUD à Djibouti et au Niger, ainsi que Spécialiste principale de la cohérence du système des Nations Unies à New York.Mme Boni Kouassi est titulaire d’un Doctorat en médecine de l’Université Félix Houphouët-Boigny, anciennement Université de Cocody à Abidjan, Côte d’Ivoire, et d’un Master en santé publique de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dans le Maryland, aux États-Unis. En plus de sa langue maternelle, le baoulé, elle parle couramment le français et l’anglais.
Mme Boni Kouassi apporte à ce poste plus de 22 ans d’expérience au sein de l’ONU, avec une expertise approfondie dans les domaines du développement, de la paix et de la sécurité, ainsi que de l’action humanitaire. Elle occupe depuis 2022 le poste de Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Niger, où elle a également assuré les fonctions de Coordonnatrice résidente et humanitaire par intérim entre 2023 et 2024. Auparavant, elle a été Représentante résidente du PNUD au Burundi entre 2019 et 2022, et Coordonnatrice résidente et humanitaire par intérim en 2021.
Précédemment, elle a également occupé plusieurs postes de direction, notamment en tant que Représentante résidente adjointe du PNUD à Djibouti et au Niger, ainsi que Spécialiste principale de la cohérence du système des Nations Unies à New York.Mme Boni Kouassi est titulaire d’un Doctorat en médecine de l’Université Félix Houphouët-Boigny, anciennement Université de Cocody à Abidjan, Côte d’Ivoire, et d’un Master en santé publique de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dans le Maryland, aux États-Unis. En plus de sa langue maternelle, le baoulé, elle parle couramment le français et l’anglais.
1 / 5

Histoire
18 septembre 2025
Haïti : de nouvelles voix s’élèvent pour l’éducation, la paix et la démocratie
10 jeunes, donc cinq écoliers et cinq étudiants, ont atteint la finale du « Concours national de Dissertation » sur le thème du droit à l’éducation, organisé par le Centre Muse Haïti, avec le support du Système des Nations Unies. Plus qu’une compétition, ce concours a permis aux participants de s’exprimer et de partager leurs opinions et leurs propositions sur la manière d’adresser la crise actuelle que traverse Haïti, affectant profondément, entre autres, le système éducatif, et l’opportunité de promouvoir l’inclusion et la participation, des fondements de la démocratie. À travers leurs textes et les sessions de joutes oratoires, ces jeunes issus de plusieurs établissements d’enseignement publics et privés ont exprimé leur vision de l’éducation comme un levier essentiel pour apprendre à dialoguer, renforcer la cohésion sociale et promouvoir les valeurs démocratiques, notamment la participation inclusive aux décisions qui influencent leur présent et leur avenir. Pour eux, le lien entre éducation et démocratie est indissociable. « Comment peut-on parler de l’émergence de la démocratie, sans adresser la question de la jouissance du droit à l’éducation ? », s’insurge Manuel Beauplan, étudiant en 3e année à la Faculté des Sciences humaines, lauréat de la catégorie-étudiant. Il n’a pas manqué de souligner les inégalités d’accès et de jouissance qui persistent dans le système éducatif, remettant en cause l’universalité du droit à l’éducation. Cette activité d’expression des jeunes donne écho à l’objectif 4 des Objectifs de développement durable (ODD) qui vise à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. C’est dans cette même perspective que s’inscrit le plaidoyer des Nations Unies en Haïti, comme l’a rappelé Ariel Pino, Coordonnateur résident a.i., lors de la cérémonie de clôture du concours le 12 septembre 2025 : « Nous sommes particulièrement touchés par la contribution du concours à mettre en avant les Objectifs de Développement Durable, et particulièrement l’ODD 4, qui appelle à une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. […] l’éducation est au cœur des six grandes transitions nécessaires pour accélérer les ODD : elle est un moteur de résilience, de cohésion sociale et d’innovation. Investir dans l’éducation, même en période de crise, c’est investir dans la paix, la justice sociale et le développement durable. »Il a plaidé en faveur de solutions durables garantissant à tous les enfants, sans distinction, un accès équitable à une éducation de qualité. Il a également souligné l’importance de maintenir des efforts soutenus pour faire face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays — une crise qui affecte profondément le système éducatif et expose de nombreux enfants à la violence, ainsi qu’au recrutement forcé par des groupes armés. « Rien que l’année dernière, le recrutement d’enfants dans les groupes armés a augmenté de 70 %. Près de la moitié des membres de ces groupes sont des enfants — certains âgés d’à peine huit ans. Aujourd’hui, 1,2 million d’enfants vivent sous la menace constante de la violence armée », a-t-il déclaré, en citant un rapport de l’UNICEF.M. Pino a tenu à féliciter les gagnants, les finalistes, ainsi que tous les participants à ce concours, pour leur engagement en faveur du droit à l’éducation et de la culture de la paix. Il a aussi salué les efforts consentis par les organisateurs et les partenaires – Centre Muse Haïti, ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Université d’État d’Haïti (UEH), Office de la Protection du Citoyen (OPC), le jury et autres partenaires – d’avoir permis aux jeunes de s’exprimer sur ces thématiques dans ce contexte particulier. Le Coordonnateur résident appelle à une plus grande mobilisation de la jeunesse à cette noble cause : Ce n’est pas un privilège que vous revendiquez ! c’est votre droit, a-t-il martelé sur le droit à l’éducation, tout en rappelant que les Nations Unies se tiennent aux côtés de la jeunesse haïtienne dans cette quête.Le discours complet du Coordonnateur résident a.i. est disponible ICI : Concours national de dissertation sur le droit à l'éducation_cérémonie de clôture | Les Nations Unies en Haïti
1 / 5

Histoire
12 août 2025
« La réponse internationale n’est pas à la hauteur » : l’adieu amer d’Ulrika Richardson à Haïti
Elle quitte Port-au-Prince le cœur lourd, à court de mots pour décrire l’ampleur de la crise actuelle. Mardi, Ulrika Richardson, coordinatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, a livré un ultime plaidoyer, emprunt de gravité et d’espoir, avant de prendre ses nouvelles fonctions en Libye à l’automne.« Est-elle alarmante ? Aiguë ? Urgente ? Elle est tout cela à la fois – et même plus », lance d’emblée la responsable devant un parterre de journalistes, à New York, évoquant la situation dans cette nation insulaire des Caraïbes, ravagée par les gangs. Le bilan : 1,3 million de déplacés, dont la moitié sont des enfants ; 3.000 morts depuis janvier ; deux millions de personnes au bord de la famine. Mais, derrière les statistiques, insiste-t-elle, « il y a une femme, un enfant, un père, un jeune ».UN Photo/Mark GartenUlrika Richardson, lors de sa dernière conférence de presse en tant que Représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), au siège de l'ONU, à New York.Cette diplomate d'origine suédoise, qui a passé plus de trois ans dans la capitale haïtienne et sillonné le pays de long en large, se dit frappée par la résilience de ses habitants. Elle cite notamment une femme violée à de multiples reprises qui, grâce à un soutien psychologique, « tient le coup, veut vivre et réclame même la justice ». Mais elle raconte aussi le drame de certains habitants, contraints d’abandonner un proche âgé ou handicapé, lors d’une fuite précipitée face aux assauts des gangs.Le tableau est sombre : malnutrition infantile, enfants enrôlés par les bandes armées, écoles fermées, hôpitaux paralysés – « seulement 36 % fonctionnent pleinement dans la capitale », rappelle-t-elle.Des outils mais pas de volontéEt pourtant, Ulrika Richardson affirme que les mécanismes internationaux sont bien en place : un plan de réponse humanitaire – « financé à seulement 9 %, soit le plus bas niveau au monde » – un régime de sanctions, un embargo sur les armes, une mission multinationale d’appui à la sécurité dirigée par le Kenya. « Nous avons les outils, mais la réponse internationale n’est pas à la hauteur de la gravité de la situation ».Interrogée sur les priorités en Haïti, celle qui intégrera la mission politique de l’ONU en Libye à partir du 1er septembre tranche : « Il faut, tout simplement, arrêter l’arrivée d’armes en Haïti », briser les liens entre gangs et élites politiques ou économiques, et donner aux policiers dé la mission multinationale les moyens d’agir. Le tout, prévient-elle, doit aller de pair avec « une solution politique » et un retour au développement, faute de quoi l’instabilité risque de s’étendre.Pourquoi cela ne se fait-il pas ? « Un mélange de manque de volonté politique, à plusieurs niveaux, et de manque de financement », répond-elle, constatant que les gangs, moins dépendants de leurs anciens parrains, vivent désormais du crime organisé régional.Malgré tout, Ulrika Richardson revendique son optimisme : « Haïti a beaucoup à offrir : un territoire relativement petit mais riche, une population dynamique, une diaspora active. Toutes les conditions existent pour tourner la page et enclencher une spirale positive vers la stabilité, la prospérité et une vie digne ». Et de conclure : « Les Haïtiens y sont prêts ». Article publié sur ONU Info
1 / 5

Histoire
23 janvier 2025
Haïti : en prise avec les gangs, les autorités font face à des défis « immenses »
Alors que l’emprise des gangs sur le territoire haïtien ne cesse de croître, alimentée par le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, deux responsables des Nations Unies ont salué, mercredi, certaines avancées politiques et sécuritaires récentes.Les gangs continuent d’étendre leur contrôle sur le territoire haïtien, a déclaré la Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Waly, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation dans le pays.Tout particulièrement actif, le gang Viv Ansanm, s'est récemment emparé de zones clés à l'intérieur et dans les environs de Port-au-Prince, a notamment indiqué Mme Waly. Selon la Directrice exécutive, cette expansion territoriale est le fruit d’une action calculée, en collaboration avec les élites politiques et économiques haïtienne, visant à prendre le contrôle des ressources du pays. De sorte qu’à l’heure actuelle, les gangs se partagent environ 85% de la capitale, a-t-elle précisé, une emprise qui s’appuie sur le trafic d’armes et de drogues, ainsi que la corruption et le blanchiment d’argent.Des tactiques de plus en plus brutalesSelon la responsable de l’ONUDC, les gangs haïtiens ont recours à des tactiques de plus en plus brutales, qui se traduisent par des affrontements meurtriers fréquents avec la population et les forces de l’ordre.En témoignent le massacre de 115 personnes par le gang Gran Grif, au mois d’octobre dernier, dans le département de l’Artibonite, l’exécution de plus de 200 personnes dans le quartier de Wharf Jérémie, à Port-au-Prince, au mois de décembre, ou encore la fermeture de l’aéroport international de la capitale suite à une attaque de gangs contre un avion de ligne, le 11 novembre.Ces violences récurrentes dans la capitale ont causé le déplacement de près de 41.000 personnes.Dans le même temps, les gangs continuent de se procurer facilement des armes et munitions, en dépit de l’embargo dont elles font l’objet.Aussi, Mme Waly a-t-elle appelé à renforcer les capacités à enregistrer, contrôler et tracer les armes et les munitions en Haïti.Plaque tournante de la drogueAu cours des dernières décennies, Haïti est devenue une plaque tournante du trafic de drogue, a par ailleurs déclaré la Directrice exécutive de l’ONUDC.Selon elle, un petit groupe d’individus composé d’anciens militaires haïtiens, d’agents des forces de l’ordre, de parlementaires et d’hommes d’affaires, a fait main basse sur le trafic de drogue depuis les années 1980. Ces derniers opèrent notamment en Haïti et aux États-Unis et utiliseraient le commerce de l’anguille pour blanchir les revenus de la drogue.La responsable de l’ONUDC a donc appelé la communauté internationale à coopérer avec Haïti pour démanteler ce réseau profondément enraciné dans le pays. Déploiement de la force kenyaneDans ce contexte de montée des violences, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour Haïti, María Isabel Salvador, a salué le déploiement, le 18 janvier, de 217 policiers kényans au sein de la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS), en plus des centaines de policiers déjà présents en provenance du Kenya et de plusieurs autres pays, dont le Guatemala, la Jamaïque, le Belize, les Bahamas et El Salvador. Ce déploiement vient s’ajouter aux 739 policiers, dont 213 femmes, tout droit sortis de l’Académie nationale de police.Autre élément positif, Mme Salvador, qui dirige également le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), a noté les efforts déployés par la police nationale haïtienne (PNH), avec l’aide de la MMAS, pour mettre fin aux violences. Selon elle, les opérations anti-gang sont de mieux en mieux planifiées et la récente nomination d’un Secrétaire d’État à la sécurité publique a lancé un signal positif à la population.« Cependant, les défis que la PNH doit relever demeurent immenses », a-t-elle reconnu, avant d’appeler la communauté internationale à venir davantage en aide au pays.Des avancées politiquesMme Salvador s’est par ailleurs félicitée de la nomination, le 11 novembre dernier, d’Alix Didier Fils-Aimé au poste de Premier Ministre.Cette avancée s’est selon elle traduite par une collaboration accrue entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition, qui a notamment permis de débloquer certains dossiers ayant trait à la gouvernance du pays.Elle a en outre salué la nomination des derniers deux membres du Conseil électoral provisoire. « Quatre des 9 membres sont désormais des femmes, une étape importante vers une plus grande inclusion du genre dans le processus électoral », a-t-elle salué. Article paru sur ONU Info
1 / 5

Communiqué de presse
18 décembre 2025
LANCEMENT DU PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2026 EN HAÏTI POUR VENIR EN AIDE À 4,2 MILLIONS DE PERSONNES
Port-au-Prince/18 décembre 2025 : La Coordonnatrice humanitaire en Haïti, Nicole Kouassi, a lancé officiellement le Plan de réponse humanitaire pour Haïti (HNRP). D’un budget de 880 millions de dollars américains, le Plan vise à venir en aide à 4,2 millions de personnes vulnérables et qui dépendent d’une assistance humanitaire vitale.La violence des groupes armés a forcé 1,4 million de personnes, soit 12 % de la population, à fuir leur foyer. 5,7 millions de personnes souffrent quotidiennement d’insécurité alimentaire sévère, plaçant Haïti parmi les six principaux foyers de faim dans le monde. Les services de base, y compris la santé et l’éducation font l’objet d’attaques régulières et continuent à fermer.« Je suis profondément préoccupée par le cycle de violence ininterrompu et le niveau de brutalité extrême que subissent les Haïtiennes et Haïtiens, a déclaré la Coordonnatrice humanitaire. Tous les jours, 27 femmes et jeunes filles subissent des violences basées sur le genre dont la majorité sont des viols, voir même des viols collectifs. Des milliers de civils innocents font l’objet de déplacements forcés, s’ils ne sont pas tués, et voient leurs maisons et autres infrastructures détruites. Les jeunes et les enfants sont enrôlés de force dans les groupes armés au point que ces derniers représentent jusqu’à 50% de leurs membres ».Le Plan de réponse humanitaire 2026 se focalise sur des interventions multisectorielles urgentes dans les départements de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite, où la violence armée et les déportations de migrants génèrent des besoins importants et sévères. Il vise à réduire les risques immédiats pesant sur les populations, stabiliser les ménages les plus affectés par les chocs et renforcer leur accès aux services essentiels. Dans les zones plus stables du Grand Sud et du Grand Nord, où ont fui un grand nombre de personnes déplacées internes, la réponse visera à soutenir leur intégration locale, à réduire la pression sur les communautés hôtes et à prévenir les tensions sociales, en coordination étroite avec les acteurs du développement.« J'appelle tous nos partenaires humanitaires et de développement, bailleurs de fonds et le Gouvernement Haïtien à soutenir le Plan de réponse humanitaire 2026, afin de préserver la vie et la dignité de chaque Haïtienne et Haïtien, et pour que l'espoir continue pour les jeunes générations », a souligné Nicole Kouassi. Pour contact:Claire Pressoir, Chargée de l’information publique, claire.pressoir@un.org, Modibo Traore, Chef de bureau, traorem@un.orgOCHA press releases are available at www.unocha.org or www.reliefweb.int.
1 / 5
Communiqué de presse
01 décembre 2025
Haïti : Journée Mondiale SIDA 2025 - « Surmonter les perturbations, transformer la riposte »
Port-au-Prince, 1er décembre 2025 – Haïti se joint à la communauté internationale pour commémorer la Journée mondiale de Lutte contre le Sida. Sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au Sida », cette journée est l'occasion de souligner les efforts conjugués autorités nationales, de la société civile et des partenaires, dans un contexte de crise complexe marqué par l’insécurité, l’instabilité sociopolitique et les défis économiques.Un appel à l'action : progrès significatifs et urgence persistanteAujourd'hui, 150 000 personnes vivent avec le VIH en Haïti, l'épidémie est fortement féminisée, avec 62 % des adultes touchés étant des femmes. Un compte 121 000 personnes sont sous traitement antirétroviral (TAR). Près de 9 adultes sur 10 (25 ans et plus) sont sous traitement.Des inégalités criantes : seulement 28 % des enfants (0-9 ans) vivant avec le VIH bénéficient du TAR.La vulnérabilité des jeunes et des filles : près de 4 jeunes de 15 à 24 ans ont été infectés par le VIH chaque jour en 2024. Les adolescentes et jeunes filles de cette tranche d'âge courent un risque trois fois supérieur de contracter le VIH que leurs homologues masculins.Cette situation est exacerbée par la crise sécuritaire, les déplacements internes de 1,4 million de personnes, et l'augmentation des violences basées sur le genre, qui menacent la continuité et la qualité des services essentiels.Le Secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé : « Les inégalités restent le principal obstacle à l’éradication du sida. ». Cela dit, il est nécessaire de travailler à combler ces inégalités qui permettront de garantir une prise en charge adéquate et adaptée aux différentes situations des communautés. En Haïti, cela implique, entre autres, de renforcer les infrastructures de prise en charge pour un accès équitable aux soins, de protéger les jeunes femmes et les survivantes de violences sexuelles, d’assurer l’accès aux traitements même en contexte d’insécurité, de soutenir les personnes déplacées et de renforcer la prévention combinée et la santé sexuelle et reproductive.En novembre 2024, la Directrice Exécutive de l’ONUSIDA, Mme Winnie Byanyima, a réaffirmé l'engagement Nations Unies à soutenir Haïti et à maintenir la lutte contre le VIH au cœur des priorités politiques en dépit des crises humanitaires.Le Système des Nations Unies en Haïti, à travers le leadership de l’ONUSIDA, apportent un appui essentiel dans la mise en œuvre de cet agenda, concrétisé entre autres, par la collaboration existante entre le Programme alimentaire mondial (PAM), l’ONUSIDA avec le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) pour promouvoir la Politique Nationale de Protection et de Promotion Sociales, mettant l’emphase sur les groupes vulnérables, dont les personnes vivant avec le VIH.Cette année, le thème « Surmonter les perturbations, Transformer la riposte au SIDA » appelle à davantage d’efforts, à plus d’actions dans un contexte de baisse des financements et où plus que jamais, il y a la nécessité d’une appropriation nationale des acquis. Pour Christian Mouala, Directeur pays de l’ONUSIDA en Haïti, ceci est un appel à l’action pour renforcer la résilience des systèmes communautaires, intégrer les services de VIH dans les soins de santé primaires et les réponses aux urgences, lutter contre la stigmatisation et les inégalités structurelles, exploiter l'innovation et la technologie digitale et garantir un financement durable et prévisible. Il existe aujourd'hui plus d'options de prévention disponibles qu'auparavant, et des preuves convaincantes de leur impact lorsque les personnes qui en ont besoin peuvent y accéder et les utiliser. Voir le dernier rapport L'ONUSIDA publie son rapport pour la Journée mondiale de lutte contre le sida 2025 | UNAIDSPour sa part, Ariel Pino, Coordonnateur résident des Nations Unies par intérim, souligne l'impératif de la pérennité : « Face à la baisse des financements internationaux, il est essentiel d’augmenter progressivement la contribution nationale et d’investir dans des infrastructures de prise en charge innovantes et adaptées pour une meilleure prise en charge ».L'Équipe pays des Nations Unies réaffirme son engagement conjoint à soutenir les autorités nationales, la société civile et les communautés pour atteindre les cibles nationales et faire du sida une menace de santé publique éliminée d’ici 2030.Contacts:Mathurin Joris│ ONUSIDA Haiti │ mathurinj@unaids.org │ +50943222279Christian Mouala │ ONUSIDA Haiti │moualac@unaids.org │ +50944777190Maison des Nations Unies/Bureau de la Coordonnatrice résidente, 15, rue Pipo, Juvénat 7, Pétion-Ville, Haïti Courriel : rcs-rco-haiti@un.org / www.haiti.un.org / X: UNHaiti
1 / 5
Communiqué de presse
30 octobre 2025
Ouragan Melissa - L’Équipe pays des Nations Unies en Haïti exprime sa profonde solidarité avec le peuple Haïtien et les pays des Caraïbes face aux ravages de l’ouragan Melissa.
Port-au-Prince, le 30 octobre 2025 – L’Équipe pays des Nations Unies en Haïti exprime sa solidarité avec le peuple Haïtien et les pays des Caraïbes, notamment la Jamaïque et Cuba, et présente ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées à la suite du passage dévastateur de l’ouragan Melissa.En Haïti, les premières évaluations font état d’un lourd bilan humain, avec au moins 24 morts, des blessés, des disparues y compris plusieurs enfants ainsi que des pertes matérielles et agricoles importantes. L’Equipe pays des Nations Unies, en étroite collaboration et coordination avec le Gouvernement Haïtien et d’autres partenaires non-étatiques, demeure pleinement mobilisée, pour soutenir les efforts de réponse et d’assistance aux populations les plus affectées. ***FIN***
1 / 5
Communiqué de presse
29 octobre 2025
Projet de Renforcement des Opportunités agricoles par la Formation et l’Investissement technologique (P.R.O.F.I.T.) / Participation d’une délégation haïtienne au Salon mondial du Chocolat
Du 29 octobre au 2 novembre 2024, le cacao haïtien sera fièrement représenté à la 30e édition du Salon Mondial du Chocolat qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles. Avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à travers le projet PROFIT financé par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège, les acteurs majeurs du cacao du sud d’Haïti comme –AYITIKA, KALEOS S.A., KAÛNA, RALPH LEROY, la Direction Départementale agricole DDAGA, et GEONOVA – feront le déplacement pour exposer et vendre les produits du cacao et leurs dérivés, et pour témoigner de la richesse et des opportunités liées à cette culture. Ces partenaires, s’unissent et s’expriment d’une seule voix pour faire connaître le délicieux cacao d’Haïti aux saveurs uniques, de la fève de cacao aux délicieuses tablettes aux arômes multiples, en passant par l’exceptionnel beurre de cacao. Ils vont aussi délivrer le message de résilience et d’espoir des productrices et producteurs qui investissent courageusement dans la filière, en dépit des défis colossaux auxquels l’agriculture haïtienne fait face. Au Salon mondial du Chocolat, les différents participants vont exposer leur savoir-faire sur la culture du cacao et sur sa transformation en produits dérivés ; ils vont aussi parler des éléments innovants qu’ils ont amenés en vue de donner un nouveau souffle à cette filière. De tels efforts ont permis à Haïti d’obtenir la certification du commerce équitable à plusieurs reprises, ce qui offre une meilleure garantie de revenus décents pour les producteurs.Les entreprises KALEOS, KAÛNA et LEROY Chocolat vont donc présenter, exposer et proposer à la dégustation le cacao (à travers des produits dérivés comme les barres de chocolat, la poudre et le beurre de cacao, le chocolat chaud et en première mondiale le biscuit CHOUCOUNE SANS GLUTEN à base de farine de fruit à pain et de cacao) issus du terroir riche et particulier d’Haïti, qui, une fois transformé, offre les saveurs les plus exotiques et raffinées. Il sera aussi question avec GEONOVA de la technologie intégrée désormais dans la gestion et la structuration de la filière, à travers la mise en place d’un système d’intelligence logistique qui permet le géoréférencement des parcelles et des productrices et producteurs. Ce qui garantit la transparence de la chaîne de valeur et la fiabilité du système de traçabilité ainsi que l’obtention de données en temps réel. Ces données permettent d’analyser, et d’évaluer l’état des lieux de la chaîne de valeur afin de prendre les bonnes décisions. En outre, cette plateforme d’intelligence logistique permet de respecter la nouvelle norme européenne EUDR de traçabilité et d’engagement contre la déforestation. Le travail de coordination des interventions avec la DDAGA, le renforcement des capacités des fournisseurs de services agricoles, l’implication et l’autonomisation des femmes ainsi que les coopératives de productrices et de producteurs seront aussi mis en avant pour témoigner de cette résilience dans un pays souvent marqué par les crises et les catastrophes naturelles.Pour cette 30e édition du Salon, l’entreprise AYITIKA qui a déjà obtenu plusieurs distinctions internationales partagera également le stand d’Haïti. Avec son approche ‘’roots to bar’’, AYITIKA s’applique à proposer aux consommateurs des tablettes de chocolat reflétant les arômes exquis des terroirs et des variétés d’exception de cacao d’Haïti. Cette participation d’Haïti au Salon mondial du Chocolat met en exergue les potentialités et les nombreuses opportunités d’Haïti, notamment dans l’agriculture. Elle fait naître l’espoir que des acteurs aux compétences et expériences diverses puissent s’unir dans toutes les sphères de la société pour contribuer à instaurer des pratiques porteuses de changement durable dans la vie des populations. Prospectus de participation d’Haïti au Salon (Les principaux acteurs d’un cacao aux saveurs singulières et raffinées) Pour contact :Fabrice LeclercqConseiller technique principal – OIT HaïtiTel : +509 3694 6825Email : leclercqf@ilo.org
1 / 5
Communiqué de presse
24 octobre 2025
L’ONU a 80 ans – Notre engagement envers Haïti reste indéfectible
Port-au-Prince, 24 octobre 2025L’Équipe pays des Nations Unies (EPNU) en Haïti célèbre cette année la Journée des Nations Unies, le 24 octobre 2025, marquant les 80 ans de l’Organisation.L’EPNU est fière de faire partie de cette institution, et encore plus honorée de servir au sein d’un État membre tel qu’Haïti, l’un des pays fondateurs des Nations Unies et qui fut parmi les premiers dans le monde contemporain à porter haut les valeurs de liberté, de respect et de protection des droits humains. Ces valeurs nous guident dans nos actions en tant qu’organisation, en Haïti et dans le monde entier.Depuis sa création, l’Organisation des Nations Unies s’est trouvée au cœur de nombreux défis à relever, dans des contextes et des situations variés. Ces défis, qui menacent la vie et la survie de populations entières, y compris en Haïti, exigent une réponse collective. Le principal levier de l’ONU réside, hier comme aujourd’hui, dans le choix de cette réponse collective et de la solidarité entre ses États membres pour faire face à ces enjeux et concrétiser la promesse fondatrice faite en 1945.Comme l’a rappelé le Secrétaire général, António Guterres, dans son message du jour : « En cette Journée des Nations Unies, soyons unis et réalisons l’extraordinaire promesse de vos Nations Unies ».Au sein de l’Équipe Pays des Nations Unies (EPNU) en Haïti, nous faisons écho à ce message en réaffirmant notre unité pour accompagner les autorités, la société civile, les associations de jeunes et de femmes, et la population haïtienne dans son ensemble, dans la réponse aux crises actuelles, qu’elles soient de gouvernance, humanitaires, sanitaires ou sécuritaires. Nous restons mobilisés pour protéger et assister les familles déplacées à cause de l’instabilité et de la violence des gangs, ainsi que les personnes migrantes déportées vers Haïti, en veillant à ne laisser personne de côté.Nous restons engagés à soutenir le renforcement du système de santé afin de garantir un accès équitable aux soins pour tous. Plus que jamais, nous restons solidaires pour soutenir les efforts visant à créer des emplois durables et décents, ainsi qu'assurer la sécurité alimentaire en renforçant l’agriculture haïtienne pour garantir une production locale, durable et accessible à toutes et tous, tout en consolidant la souveraineté alimentaire nationale. Nous réaffirmons notre engagement collectif à appuyer les actions permettant aux enfants et aux jeunes de jouir pleinement de leur droit à la protection, à la santé et à l’éducation, et à créer les conditions propices au bon fonctionnement de services de bases. Nous restons déterminés à aider Haïti à se relever durablement, sans laisser personne par compte, et à bâtir des communautés plus résilientes face aux crises multiples. Nous restons fermement engagés en faveur des actions qui promeuvent la paix, le respect des droits humains, le développement durable, la valorisation de l’art et de la culture, la transition verte, la lutte contre la violence basée sur le genre et les violences sexuelles, la transparence institutionnelle, et la lutte contre la corruption. En cette journée, nous appelons collectivement tous les acteurs nationaux et tous les partenaires du développement à œuvrer pour réaliser la promesse d’une Haïti stable, prospère, et rayonnante au sein de la grande famille des Nations Unies. ***FIN***
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
22 mai 2025
Ressources
20 avril 2023
Ressources
18 janvier 2023
Ressources
09 novembre 2022
Ressources
17 octobre 2022
Ressources
30 septembre 2022
1 / 11